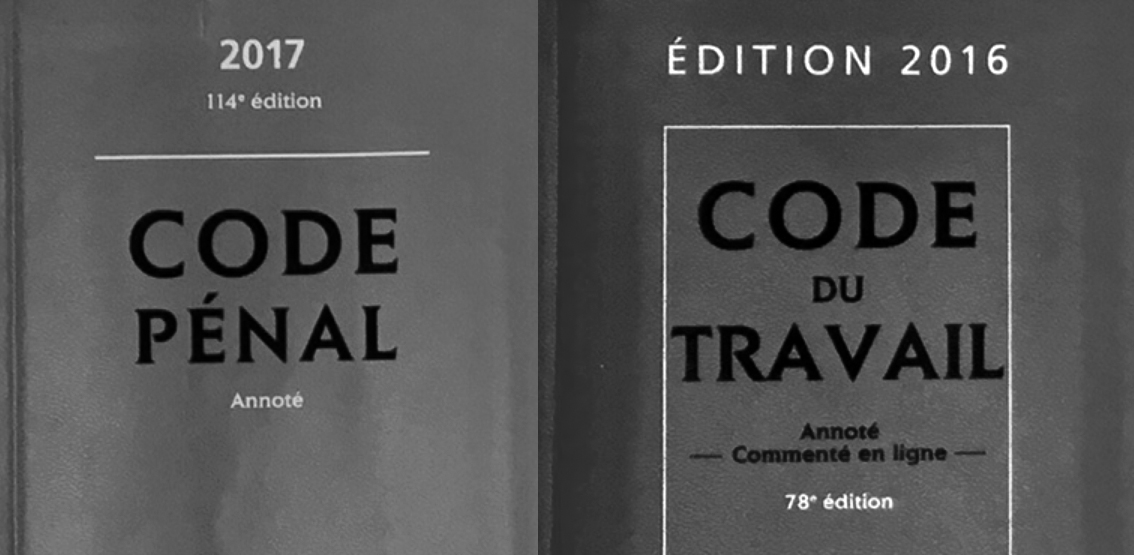Et si le management contemporain se trompait sur les véritables ressorts du bonheur professionnel et de la qualité de vie au travail (QVT) ? C’est la thèse que défend Philippe Schleiter, consultant et spécialiste du changement dans les organisations, dans son ouvrage Management, le grand retour du réel (VA Éditions, 2017). Afin de stimuler notre réflexion et celle de nos partenaires, nous lui avons demandé de préciser sa pensée, à bien des égards iconoclaste.
Et si le management contemporain se trompait sur les véritables ressorts du bonheur professionnel et de la qualité de vie au travail (QVT) ? C’est la thèse que défend Philippe Schleiter, consultant et spécialiste du changement dans les organisations, dans son ouvrage Management, le grand retour du réel (VA Éditions, 2017). Afin de stimuler notre réflexion et celle de nos partenaires, nous lui avons demandé de préciser sa pensée, à bien des égards iconoclaste.
Conjuguer travail et bonheur, est-ce la nouvelle martingale managériale ?
Il est vrai que depuis quelques années, le thème du bonheur professionnel a fait une entrée fracassante dans l’univers managérial. Ainsi, tandis que certaines entreprises créaient des postes de “managers du bonheur” chargés de veiller au quotidien sur le bien-être des salariés, d’autres décidaient de considérer cette nouvelle mission comme une compétence managériale à part entière. Et les cadres d’être désormais également évalués à l’aune du bonheur et de la joie qu’ils répandraient dans leurs équipes ! Ces initiatives sont toutefois trop récentes pour pouvoir estimer leur véritable impact : favorisent-elles réellement le bien-être des salariés ou rajoutent-elles un facteur de stress à des cadres qui n’avaient pas besoin de cela ? Je trouve ainsi pour le moins inquiétant que des cadres puissent être mis en cause pour ne pas avoir identifié ou réagi efficacement aux risques psychosociaux (RPS) dont peuvent être victimes certains de leurs collaborateurs, alors qu’ils n’ont pas été formés pour cela. Cela me semble d’autant plus mal venu que les instruments les plus fréquemment proposés pour atteindre ce Graal du bonheur au travail sont pour le moins superficiels. Ainsi, au rang des initiatives les plus en vue : les salles de sport, les conciergeries sans oublier bien sûr les cafétérias design et autres lieux de convivialité – voire de relaxation – qui, avec leur mobilier aux couleurs acidulées et leurs plantes vertes, donnent à certaines entreprises de faux airs de centres de vacances branchés, à moins qu’ils n’évoquent des centres commerciaux…
Vous semblez dubitatif quant à ces initiatives… Pourtant n’est-il pas légitime et bénéfique de vouloir réconcilier travail et plaisir ?
C’est d’autant plus légitime que cela correspond à une aspiration profonde de la part des salariés eux-mêmes. En effet, contrairement à ce que peut laisser croire l’avènement des 35 heures, l’immense majorité de nos compatriotes vénère en effet la « valeur travail ». Comme le note Alain d’Iribarne, économiste et directeur de recherche au CNRS, “on nous a bassinés avec la réduction du temps de travail et l’avènement de la société des loisirs, mais c’est une illusion. Le travail reste au cœur de notre société” (1). Pour s’en convaincre, il suffit d’ailleurs de souligner l’importance croissante du travail et de la vie professionnelle aux yeux des femmes. En effet, pourquoi les femmes batailleraient-elles pour poursuivre des carrières professionnelles similaires à celles des hommes, si le travail n’était qu’une aliénation et non un moyen de réalisation de soi et une activité gratifiante ?
Dans un célèbre ouvrage, la sociologue Dominique Méda va également à l’encontre des clichés dont sont affublés les Français s’agissant de leur rapport au travail (2). Elle souligne en effet “l’attachement particulier des Français au travail”. Car, contrairement à une idée reçue, nos compatriotes sont, parmi les Européens, ceux qui manifestent le plus grand attachement au travail, 70 % d’entre eux affirmant qu’il est “très important” à leurs yeux. Une proportion qui les place loin devant les Britanniques (40 %) ou les Allemands (50 %) mais qui, dans un paradoxe apparent, complique significativement la tâche des employeurs français. En effet, la singularité française tient plutôt à la nature des aspirations professionnelles. “À partir du moment où l’on aborde la question de l’intérêt intrinsèque accordé au travail, la France se démarque nettement des autres pays européens”. Ainsi, les Français ont “des attentes extrêmement fortes en matière de réalisation et d’expression de soi dans le travail”.
Dès lors, comment expliquer le malaise ou l’incrédulité que manifestent certains salariés en découvrant les initiatives concrètes prises pour favoriser le bonheur professionnel ?
Il y a d’abord le sentiment diffus que les notions dont on parle de façon incantatoire sont précisément celles qui ont déjà disparu… Chacun sait en effet que l’on a jamais tant parlé de « respect » depuis la disparition de la courtoisie et de convivialité depuis que l’on se moque du sort de son prochain. N’en est-il pas de même pour le bonheur professionnel ?
Il y a aussi comme un petit parfum de manipulation, les initiatives prises semblant formatées pour être remarquées de tous, salariés et médias, ce qui n’est pas sans rappeler les enseignements du sociologue australien Elton Mayo qui, dans les années 20, mena une série d’expériences mettant en évidence une sorte d’effet placebo des mesures prises pour améliorer les conditions de travail (3). Après avoir constaté que l’augmentation de l’éclairage dans les ateliers d’une usine améliorait la productivité, il remarqua que cette productivité augmentait également lorsque, ultérieurement, on revenait au niveau d’éclairage initial… De là à voir dans les cafétérias design des versions relookées des expériences de Hawthorne, il n’y a qu’un pas bien vite franchi par nombre de salariés…
Pour ma part, j’ai toutefois acquis la conviction que leurs sarcasmes grinçants à l’égard de ces initiatives ne révèlent nullement un esprit d’obstruction systématique à toute initiative venant de la direction. Plus fondamentalement et plus subtilement, en haussant les épaules face à ces réalisations, ils expriment plutôt leur désir de voir traités leurs véritables motifs d’insatisfaction, voire de frustration.
Est-ce à dire que les mesures prises ne correspondent pas aux attentes réelles des salariés ?
Il semble en effet que la louable volonté des employeurs de favoriser le bonheur professionnel de leurs employés se heurte aujourd’hui à bien des préjugés. En effet, prisonniers d’une vision erronée, de nombreux patrons persistent à ne voir dans le travail de leurs subordonnés que des tâches rébarbatives dont ces derniers ne s’acquittent – de mauvaise grâce – qu’en raison de contreparties extérieures au travail. En caricaturant à peine, nombre d’employeurs continuent de penser que les salariés n’aiment pas leur travail et qu’ils ne se lèvent le matin que pour toucher le salaire qu’ils perçoivent en contrepartie de leur peine. Or, si cette conception pouvait se comprendre à l’époque du taylorisme – et encore… –, elle est aujourd’hui parfaitement erronée. En réalité, les salariés attendant de leur travail bien autre chose qu’une rémunération. Ils veulent, conformément au discours managérial qui a valorisé leur esprit d’initiative, leur autonomie et leur créativité, trouver leur plaisir dans le travail lui-même. Si bien qu’ils voient dans les mesures prises par leurs employeurs, au mieux des gadgets sans véritable importance, au pire des écrans de fumées destinés à masquer une dégradation de leur travail réel. Parfois, ils ressentent même une forme de honte et de colère face à des initiatives qu’ils jugent infantilisantes. Un syndicaliste d’un certain âge me confiait ainsi sa sidération devant ce triomphe apparent de ce qu’il qualifiait de « maternalisme » en référence bien sûr à l’ancien paternalisme. “On nous considère comme des enfants que l’on peut consoler avec des joujoux et qui ne demandent rien d’autre que d’aller se réfugier dans les jupes de leur entreprise”, enrageait-il…
Le bonheur au travail serait donc l’objet d’un immense malentendu ?
Effectivement car lorsque l’on réduit le bonheur professionnel à une forme de bien-être, de confort et de protection, on méconnaît les ressorts profonds du bonheur humain. Piégés par l’extension à l’infini des bienfaits de l’État Providence, nous en sommes en effet venus à penser que le bonheur se confond avec la sécurité. Or, comme l’avait bien perçu et exprimé Jean de La Fontaine dans sa fable sur “le loup et le chien”, il n’est pas sûr du tout qu’il en soit ainsi. Certaines études récentes réalisées dans des disciplines aussi variées que l’éthologie, la neuropsychologie ou la sociologie du travail tendent même à démontrer le contraire.
Il semblerait même que le goût du risque soit une loi du vivant. À l’occasion d’une récente étude publiée par la revue Science et portant sur les éléphants, des chercheurs britanniques ont ainsi démontré que mener une vie libre et aventureuse est meilleur pour la santé (4). Le professeur Ros Clubb et ses collègues ont étudié le cas de 786 éléphants d’Afrique et d’Asie vivant dans des zoos européens. Puis ils les ont comparés à leurs congénères vivant en liberté au Kenya et en Birmanie. Or, il en ressort que les éléphants choyés dans des zoos par une armada de soigneurs et de vétérinaires ont une espérance de vie bien inférieure à celles de leurs congénères affrontant les nombreux dangers de la vie sauvage : 19 ans contre 42 ans pour les éléphants d’Asie et 17 ans contre 56 pour ceux d’Afrique ! Et d’en conclure que si la loi de la jungle n’est pas sans danger, il faut aussi se défier des environnements hyperprotégés, dépourvus de risques et de défis, parce que ceux-ci contribuent à nous tenir non seulement en éveil mais aussi en vie !
Vous me permettrez toutefois de remarquer que les salariés de l’entreprise ne sont pas des éléphants…
Bien sûr, mais justement, il leur est d’autant plus essentiel d’exercer leur libre arbitre, de faire des choix et de vivre de nouvelles expériences ! C’est là une nécessité vitale, d’ailleurs bien perçue par le philosophe Paul Ricœur qui voit dans “l’amputation du pouvoir d’agir” l’une des principales causes de souffrance chez l’homme (5) .
D’ailleurs certains dirigeants excellent à tirer parti de ces observations. Ainsi de Tony Hsieh PDG de Zappos – entreprise américaine de vente en lignes de chaussures pesant plus d’un milliard de dollars – qui explique avoir “mis au cœur de ses préoccupations, le bonheur de ses clients bien sûr, mais aussi celui de ses employés”. Mais certainement pas en recourant aux gadgets habituels ! De façon plus exigeante et conséquente, il estime en effet que le bonheur résulte avant tout, pour les individus, de quatre éléments : la maîtrise de leur destinée, la conscience de progresser, la qualité des relations nouées et le sentiment de participer à une œuvre qui les dépasse.
Des principes parfaitement transposables dans la pratique managériale la plus concrète. Un exemple : chez Zappos, la promotion des employés au poste d’acheteur adjoint était initialement examinée au bout de 18 mois. Cette méthode a été abandonnée au profit d’une progression en trois étapes de 6 mois, de façon à créer chez les salariés un sentiment de progrès permanent, source de satisfaction. Autre exemple : convaincu que seuls les projets imposés d’en haut suscitent la crainte, Tony Hsieh s’est attaché à privilégier les transformations venant de la base. Car les gens s’investissent davantage dans les projets qu’ils ont le sentiment de maîtriser et qu’ils désirent.
Cet exemple n’illustre-t-il pas une autre critique adressée au “management du bonheur”, certains n’y voyant qu’un moyen, pour l’entreprise, de renforcer l’implication de leurs salariés ?
Le lien entre bonheur des salariés et performance de l’entreprise est incontestable, mais pour ma part, j’inverse le lien de causalité le plus souvent mis en avant. On dit souvent que le bonheur crée l’implication. Je considère plutôt que l’implication crée le bonheur. Car rien ne rassasie autant le cœur de l’homme que l’action. Ce constat est d’ailleurs confirmé par de nombreux travaux de recherche. Professeur de psychologie à Harvard, Daniel Gilbert estime ainsi que nous surévaluons souvent la joie que procure la possession de nouvelles choses. “Certes, une nouvelle maison va vous rendre plus heureux, mais pas tant que cela et pas très longtemps” (6). Pourquoi ? Tout simplement parce que la possession nous procure moins de plaisir que l’action. À l’issue d’une étude portant sur 15.000 personnes, Matthew Killingsworth, chercheur à Harvard, a également mis en évidence que “le bonheur au travail résulte avant tout de l’interaction avec les collègues, du projet dans lequel nous sommes investis et de la qualité des contributions quotidiennes”, tandis “qu’un salaire élevé ou un titre prestigieux n’a qu’un impact limité” (7).
Autant dire que, pour favoriser le bonheur de ses employés, il ne faut nullement renoncer à exprimer de l’exigence à l’égard de ses collaborateurs. D’autant que la pire situation que puisse affronter un individu est l’inaction et le sentiment d’inutilité. “Le bonheur ce n’est pas de rester assis à regarder le mur. Cela, c’est ce que les gens font quand ils s’ennuient. Or les gens détestent s’ennuyer. Les êtres humains sont plus heureux quand ils sont challengés avec intelligence, quand ils poursuivent des objectifs difficiles mais pas impossibles à atteindre”, ajoute le Professeur Gilbert. C’est cette volonté de progresser qui motive les sportifs, les artistes, les scientifiques mais aussi chacun d’entre nous au travail.
Dès lors que devraient faire, selon vous, les employeurs réellement soucieux du bonheur de leurs salariés ?
Accompagner des équipes dans des projets de transformation ambitieux m’a permis de vérifier, sur le terrain, les vrais ressorts de l’émotion, de l’envie, du plaisir et donc du bonheur d’une équipe au travail. Ce sont, l’action, voire la prise de risque et le danger surmonté. Ce qui motive, ce qui rend fier, c’est la prise de risque assumée au nom du collectif auquel on appartient et qui vous regarde. C’est aussi la reconnaissance de l’autre et la fierté de ses réussites ou même d’avoir essayé de réussir. Si les employeurs ont raison de vouloir rechercher le bonheur de leurs salariés, cela ne signifie pas qu’ils doivent les chouchouter, les choyer, les dorloter ou les consoler et se transformer en nounou. Pour faire le bonheur de leurs employés, les employeurs doivent leur offrir ce que seule la vie professionnelle peut aujourd’hui leur apporter : un zeste d’aventure, des défis collectifs exaltants, des projets porteurs de sens, des occasions de se sentir utiles et de se surpasser. Mais attention, ils doivent aussi leur donner tous les moyens de poursuivre ces ambitions. À mon sens, l’immense majorité des pathologies psychiques liées au travail provient avant tout du décalage entre les objectifs fixés et les moyens alloués pour les atteindre. Lorsque l’on offre aux salariés les moyens nécessaires pour remplir leurs missions et qu’ils y parviennent, alors ils vivent une forme de bonheur professionnel. En revanche, si on leur assigne des objectifs inaccessibles faute de disposer des compétences, des connaissances, du temps, des ressources matérielles ou des marges de manœuvres nécessaires, alors les salariés sont en danger. Ils sont exposés à la frustration et risquent même de se dévaloriser en s’attribuant les causes d’un échec qui, pourtant, résulte de lacunes dans l’organisation de l’entreprise…
Finalement, à vous entendre, il semble que le bonheur professionnel est bel et bien une question managériale…
Oui, dans le sens où le bonheur professionnel des travailleurs résulte d’un management efficace. J’attire d’ailleurs l’attention des managers sur le point suivant : les salariés sont malheureux au travail lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’être efficaces, de faire du “bon travail”. Pour les managers, les risques psychosociaux (RPS) sont des symptômes de dysfonctionnements qui révèlent une organisation ou un mode de management inadaptés. Il est donc tout à fait pertinent d’y prêter attention et de réaliser un diagnostic des RPS, ainsi que de suivre dans la durée l’évolution de la Qualité de vie au travail (QVT) mais à condition d’agir ensuite en véritable manager et non en nounou, parce que ce n’est pas son rôle et que cela ne contribuerait qu’à aggraver le mal en niant cette réalité : au travail, le bonheur doit résulter… du travail !